Version française / Actualités / Calendrier
- Recherche - DSP,
Cycle Actualité de la recherche - Séance 2
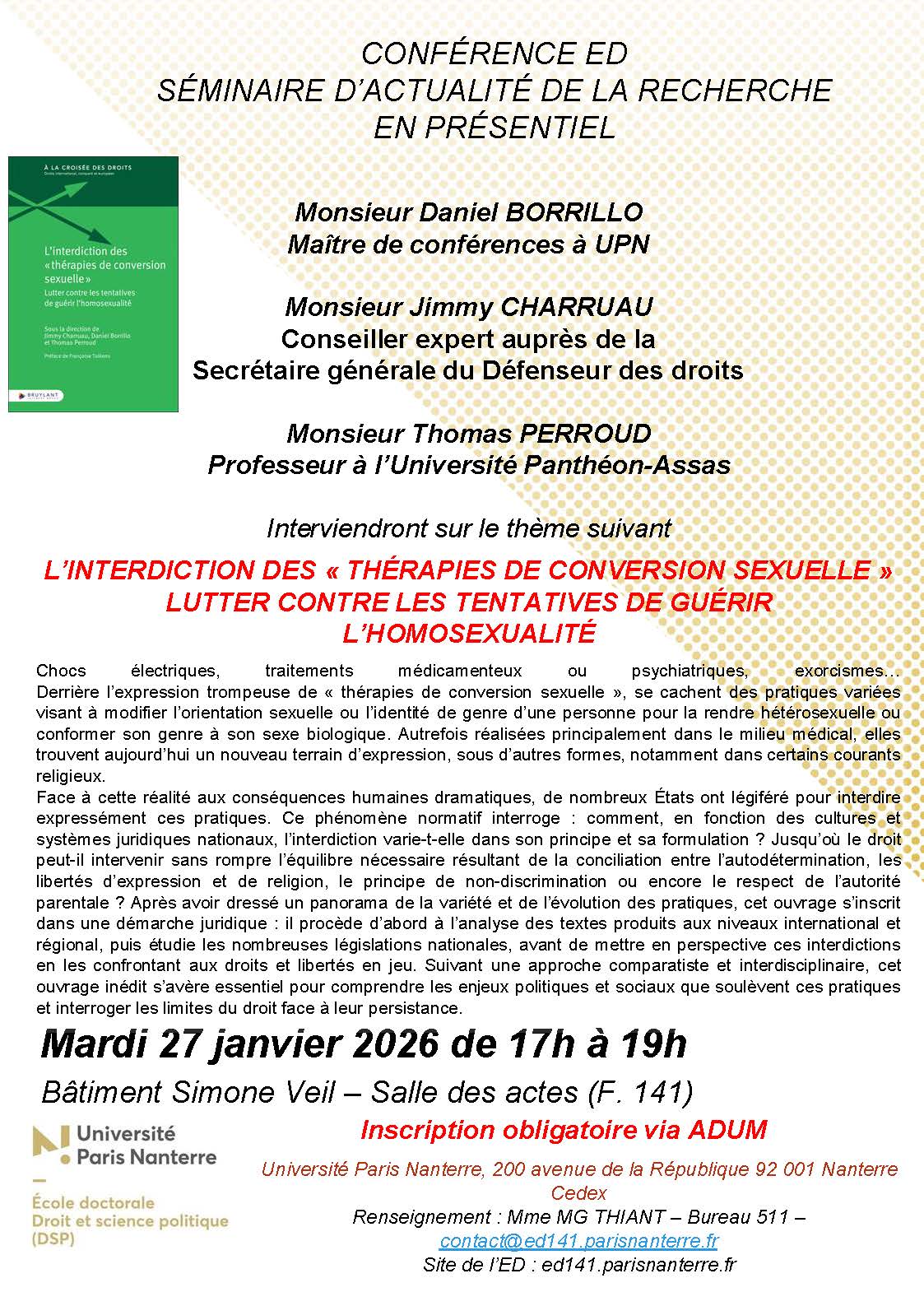
REPORT DE LA CONFÉRENCE À UNE DATE ULTÉRIEUR Chocs électriques, traitements médicamenteux ou psychiatriques, exorcismes… Derrière l’expression trompeuse de « thérapies de conversion sexuelle », se cachent des pratiques variées visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne pour la rendre hétérosexuelle ou conformer son genre à son sexe biologique. Autrefois réalisées principalement dans le milieu médical, elles trouvent aujourd’hui un nouveau terrain d’expression, sous d’autres formes, notamment dans certains courants religieux.
le 27 janvier 2026
Bâtiment Simone Veil (F)
Cycle Actualité de la recherche
M. Daniel BORRILLO
Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
M. Jimmy CHARRUAU
Conseiller expert auprès de la Secrétaire générale du Défenseur des droits
M. Thomas PERROUD
Professeur à l’Université Paris Panthéon Assas
Interviendront sur le thème
L'INTERDICTION DES "THÉRAPIES DE CONVERSION SEXUELLE"
LUTTER CONTRE LES TENTATIVES DE GUÉRIR L'HOMOSEXUALITÉ
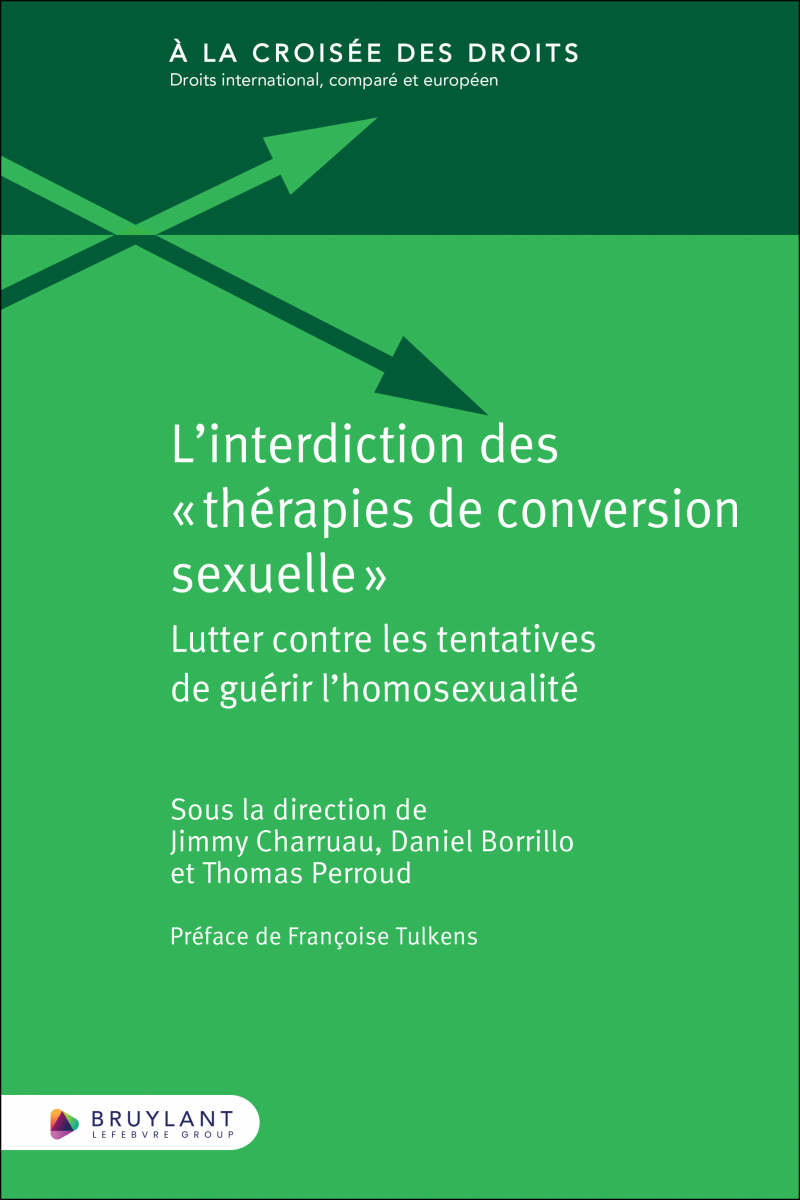
Chocs électriques, traitements médicamenteux ou psychiatriques, exorcismes…
Derrière l’expression trompeuse de « thérapies de conversion sexuelle », se cachent des pratiques variées visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne pour la rendre hétérosexuelle ou conformer son genre à son sexe biologique. Autrefois réalisées principalement dans le milieu médical, elles trouvent aujourd’hui un nouveau terrain d’expression, sous d’autres formes, notamment dans certains courants religieux.
Face à cette réalité aux conséquences humaines dramatiques, de nombreux États ont légiféré pour interdire expressément ces pratiques. Ce phénomène normatif interroge : comment, en fonction des cultures et systèmes juridiques nationaux, l’interdiction varie-t-elle dans son principe et sa formulation ? Jusqu’où le droit peut-il intervenir sans rompre l’équilibre nécessaire résultant de la conciliation entre l’autodétermination, les libertés d’expression et de religion, le principe de non-discrimination ou encore le respect de l’autorité parentale ? Après avoir dressé un panorama de la variété et de l’évolution des pratiques, cet ouvrage s’inscrit dans une démarche juridique : il procède d’abord à l’analyse des textes produits aux niveaux international et régional, puis étudie les nombreuses législations nationales, avant de mettre en perspective ces interdictions en les confrontant aux droits et libertés en jeu. Suivant une approche comparatiste et interdisciplinaire, cet ouvrage inédit s’avère essentiel pour comprendre les enjeux politiques et sociaux que soulèvent ces pratiques et interroger les limites du droit face à leur persistance.
Mis à jour le 23 janvier 2026







